Quand j’ai terminé ma lecture de la quatrième de couverture d’Il était une fois dans l’Est, des mots se sont assemblés dans mon cerveau et ont formé la pensée suivante : je me demande comment ça se termine, mais sûrement pas par un happy end. Il suffit pourtant de lire le roman d’Árpád Soltész pour se rendre compte que « happy », ici, est une notion toute relative.
Article publié le 13 septembre 2019 sur le blog littéraire Passage à l’Est.
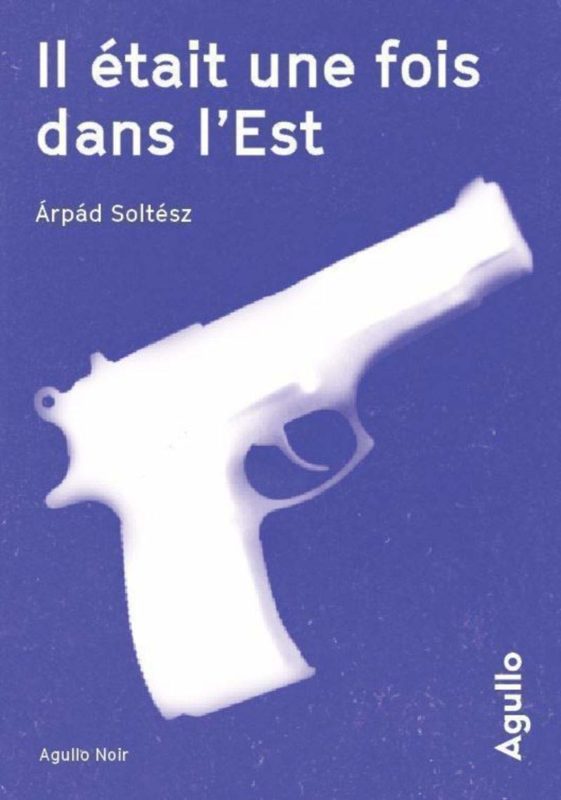
C’est en fait par la fin que le livre commence, avec ses trois pages d’ouverture qui nous font assister en direct à l’explosion du juge Kešela, victime d’une bombe alors qu’assis dans les toilettes il lisait le quotidien local. Cette scène, chapeautée d’un « Dans l’Est, à présent », est suivie d’un fast backward qui nous projette « Dans l’Est, autrefois », c’est-à-dire une quinzaine d’années auparavant. C’est là, au grand carrefour devant l’hypermarché d’un coin paumé de l’Est de la Slovaquie, que débute l’action, lorsque Veronika, auto-stoppeuse qui fait plus que ses 17 ans, monte dans la voiture de Ďod’o dit Mammouth, et de Vasil’ le Russe aux yeux globuleux. C’est quelques kilomètres plus loin, dans l’appartement de banlieue où Veronika, violée, doit être vendue comme chair à prostitution à un gang kosovar, qu’un petit grain de sable vient s’insérer dans la mécanique prévue par Mammouth et le Russe : Veronika s’enfuit.
Font alors leur apparition Miko et Valent le Barge, les deux policiers chargés du dossier, et leur compère Pavol, journaliste pour la presse locale, dont les efforts pour suivre et démêler toutes les ficelles de l’histoire vont nous tenir occupés pendant les 300 pages suivantes. Car, vous vous en doutez bien, il ne s’agit pas « juste » d’un enlèvement et d’un viol : derrière Mammouth et le Russe se profilent différents groupes d’intérêt parmi les plus sombres et les plus cyniques de la société slovaque (et pas que slovaque, d’ailleurs).
Trafic d’êtres humains, petite et grosse contrebande, corruption, double-jeu des services secrets, collusion de la justice, influence des réseaux militaires ukrainiens et russes … tout y passe sans que cela paraisse exagéré, sans doute parce qu’Árpád Soltész s’est beaucoup inspiré de la réalité qu’il chronique en tant que journaliste depuis les années 1990.
Je n’ai pas une grande expérience du roman noir (ni en général du roman policier). Si je devais m’auto-évaluer, je me mettrais sans doute dans la catégorie « Agatha Christie », c’est-à-dire quelque part entre novice et débutant sur l’échelle de la violence et du glauque. Je ne connais donc pas suffisamment les ficelles du genre pour pouvoir juger si Il était une fois dans l’Est est un roman conventionnel ou non, par sa facture et ses personnages. Cependant tous les éléments qui font ce roman ont plu à la lectrice que je suis, notamment l’imbrication et le dosage de l’intrigue et du contexte. Les deux sont inséparables, à tel point qu’on ne peut pas tant parler de « rebondissements » dans l’intrigue, que de dévoilement des différentes couches de contexte slovaque qui compliquent le travail de notre trio de policiers et journaliste tout en nous brossant un portrait peu reluisant de la Slovaquie de la période entre la chute du communisme et l’accession à l’Union européenne. Trafic d’êtres humains, petite et grosse contrebande, corruption, double-jeu des services secrets, collusion de la justice, influence des réseaux militaires ukrainiens et russes … tout y passe sans que cela paraisse exagéré, sans doute parce qu’Árpád Soltész s’est beaucoup inspiré de la réalité qu’il chronique en tant que journaliste depuis les années 1990. Les Hongrois – politiciens et réseaux de crime organisé – ayant aussi un petit rôle à jouer dans cette histoire, on trouve même dans le roman une référence à l’attentat de la rue Aranykéz qui m’a presque fait me sentir chez moi (en 1998 en plein centre de Budapest, l’explosion d’une voiture piégée tua quatre personnes et en blessa des dizaines au cours d’un épisode particulièrement sanglant de la guerre des mafias hongroise (avec participation slovaque) des années 1990).
Il y a donc les grands éléments de contexte qui nourrissent le livre et le rendent fascinant, et puis il y a les personnages. L’objectif de Soltész n’est visiblement pas d’offrir un portrait psychologique poussé de ses protagonistes, cependant les mécanismes qui poussent nombre d’entre eux à mettre le doigt dans l’engrenage du crime sont souvent assez bien dépeints (c’est d’ailleurs souvent ceux pour lesquels Soltész a un peu d’affection qui ont droit à ce traitement). On trouve aussi une certaine sympathie pour les gens « normaux » qui, à l’instar des parents de Veronika, n’ont a priori aucune chance de s’en sortir sans l’argent ou les contacts nécessaires. Hormis Veronika et Andrea la procureure, c’est un monde essentiellement masculin, marqué par un modèle de virilité assez particulier et en tout cas dénué de « bons » et de « méchants ». Si Andrea se démarque par une fermeté de caractère que son physique de poupée n’indique pas de prime abord, le personnage de Veronika se développe dans l’ombre : de victime silencieuse et quasi-absente, elle devient actrice de sa propre revanche d’une manière pour le moins surprenante.
La structure du roman peut dérouter un peu, pas tant par les quelques va-et-vient entre passé et présent que parce qu’il nous faut nous aussi frayer notre chemin dans ce monde de personnages affublés de surnoms, et parce que les dialogues s’enchaînent parfois en changeant de lieu et de protagonistes à la vitesse de l’éclair, ce qui contribue certainement à établir rapidement l’atmosphère et le rythme soutenu du roman. Tout cela est porté par une traduction qui m’a parue très réussie étant donné l’exigence de la langue si imagée et terre à terre qu’utilise Soltész pour décrire ce monde interlope, ses codes et ses secrets.
Journaliste d’investigation depuis les années 90, Árpád Soltész est né en 1969 et a grandi à l’est de la Slovaquie à Košice (ville natale, 69 ans auparavant, de Sándor Márai). Il était une fois dans l’Est est son premier roman. Il est co-fondateur et directeur depuis janvier 2019 du centre d’investigation Ján Kuciak, du nom du journaliste d’investigation slovaque assassiné (probablement sur commande) avec sa compagne Martina Kušnírová, le 21 février 2018. Un assassinat qui a malheureusement montré que la Slovaquie est loin de s’être débarrassée de la corruption et de l’impunité des milieux politiques et des affaires qui fournissent sa trame au roman de Soltész.
Árpád Soltész, Il était une fois dans l’Est (Mäso – Vtedy ny východe, 2017). Traduit du slovaque par Barbora Faure. Agullo Editions, 2019.
