United States of Love dresse le portrait croisé de quatre femmes en Pologne en 1990. Leurs trajectoires s’inscrivent dans un contexte grisâtre et transitionnel, placé au carrefour d’une histoire communiste déclinante et des modèles capitalistes émergents. Pour discuter de son approche pour le moins radicale, nous avons rencontré le cinéaste polonais Tomasz Wasileswski, à l’occasion de la sortie du film en France le 5 avril prochain.
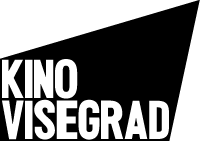 |
Cet article fait l’objet d’une publication commune avec l’association Kino Visegrad, site d’information et de diffusion du cinéma centre-européen dans l’espace francophone. |
Vous avez réalisé trois longs métrages : Dans la chambre à coucher (W sypialni, 2012), Les Gratte-ciels flottants (Płynące wieżowce, sorti en France sous le titre Ligne d’eau, 2013) et United States of Love (Zjednoczone Stany Miłości, 2016). Il semblerait qu’en comparant les trois œuvres, on puisse dire que le cinéma pour vous est un microscope explorant la vie intime. Considérez-vous l’intimité comme une sphère majeure de l’existence ?
L’intimité est une chose cruciale dans la vie des êtres humains. C’est la base. Mais je ne réduis pas l’intimité à la sexualité, ce qui m’intéresse c’est l’intimité, tout simplement. Ma motivation pour faire des films s’appuie sur l’envie de trouver une certaine vérité sur les gens, d’essayer de dresser le portrait de leurs émotions. Et analyser l’intimité, dans un tel processus, se révèle essentiel. Étudier les rapports psychologiques me rend plus proche des êtres humains.
Quel champ recouvre, selon vous, la notion « d’intimité » ? S’agit-il des sentiments, des liens psychologiques, ou de la façon dont le systèmes politiques encadrent les relations ? Ou bien est-ce le mélange de tout ces éléments ?
L’intimité, selon moi, signifie ce qui entoure chaque être humain : les choses les plus naturelles, les plus simples. Ce sont les choses les plus ordinaires qui m’inspirent, les expériences vécues par les gens qui vivent la porte d’à-côté. Selon moi, les éléments microscopiques sont les plus importants. Ils concernent chacun d’entre nous, aux quatre coins du monde. C’est ça que j’appelle l’intimité. En ce qui concerne le système politique, je le considère toujours comme la toile de fond. J’emploie effectivement les aspects sociaux et politiques comme un arrière-plan où évoluent mes personnages. Cela permet à l’histoire d’atteindre une échelle un peu plus large. Mais ce sur quoi j’insiste et ce qui m’intéresse, ce sont les choix que chaque personnage doit faire. Je mets l’accent sur les dilemmes personnels, plutôt que sur l’atmosphère environnante.
Doit-on comprendre d’un tel positionnement que l’intimité peut être explorée non seulement dans la sphère privée mais aussi dans l’espace public ?
Oui. Mais c’est une question très générale. Ce sont les gens eux-mêmes qui créent la distinction entre les sphères privée et publique. L’intimité, on peut l’apercevoir partout.
Pour approfondir la question, tout en l’inscrivant plus précisément dans votre démarche cinématographique, l’impression rendue par vos films est qu’en tant que cinéaste vous instituez une relative distance avec les personnages. Sentez-vous la nécessité d’être distant à leur égard ? Ou bien, au contraire, est-ce une manière de révéler les rapports complexes qui sont tissés collectivement ?
D’une certaine façon, je fais les deux. Je suis très proche de mes personnages. De plus, lorsque je travaille avec le comédiens, nous sommes aussi excessivement proches des émotions que nous essayons de faire jaillir. Avant le tournage, j’ai organisé des répétitions avec eux pendant de nombreux mois. J’utilise ces moments pour préparer et comprendre les émotions. L’objectif est d’être le plus proche les uns des autres, de façon à créer les conditions d’apparition des sentiments. Chacun doit se fonder sur ses propres expériences, ses propres souvenirs. Il me paraît impensable de ne pas faire cela, ce serait un mensonge. En même temps, je dois le dire : j’essaie d’être distant. Peut-être que l’adjectif “distant” n’est pas le plus approprié. Disons qu’en tant que réalisateur, j’essaie de ne pas aider mes personnages; je n’ai pas envie de les sauver.
Donc, si le terme « distant » ne convient pas, peut-être qu’il faudrait dire « retenu » ?
Lorsque je tourne un film, je tente de voir chaque situation comme un observateur. Je ne veux pas dire aux spectateurs ce qu’ils doivent penser des personnages. J’aime beaucoup mes personnages, je suis en empathie avec eux. Mais je ne veux pas imposer ma perspective, même si je sais qu’elle apparaît dans le film. J’essaie de minimiser mon point de vue, de façon à ce que le film soit libre. Vous comprenez ?
Pour rendre ce point encore plus clair, pourriez-vous expliquer ce qui vous gêne dans l’idée de distance ?
Je n’ai aucune distance ni par rapport au film, ni par rapport aux personnages. Jamais. Je suis en permanence avec eux. Je suis en eux, d’une certaine façon. Si j’instaurais une distance, ce serait comme une séparation. Mais sur le tournage, je les laisse être comme ils sont. Je n’interviens pas. Même si j’aime mes personnages, je ne les aide pas, je refuse de les prendre dans mes bras. Et je ne fais rien pour que les spectateurs les apprécient. Dans le monde réel, quelquefois nous agissons mal ou bien; je veux rendre la même chose en filmant mes personnages. Ils ne sont pas de mauvais personnages, mais parfois ils font des choses mauvaises. C’est fascinant.
Dans ma première question, j’utilisais le mot « microscope » pour qualifier votre cinéma. Mais peut-être qu’il s’agit davantage d’une sorte « d’aquarium ». Que pensez-vous de la métaphore ?
Oui. Peut-être. C’est votre travail.
Revenons un peu sur votre parcours. Vous avez étudié à l’école nationale de cinéma de Łódź, en Pologne. Est-ce que cette approche de l’intimité était quelque chose que vous partagiez avec les autres étudiants, ou bien avec les cinéastes que vous avez rencontrés ?
J’ai un parcours un peu particulier. À Łódź, je n’ai pas étudié dans le département de réalisation, mais dans celui de production. Mon idée était de faire un long-métrage dès que possible. J’étais certain, dès le début, que je serai scénariste et réalisateur. Alors j’ai avancé par mes propres moyens. J’ai réalisé mon premier long-métrage, Dans la chambre à coucher, de façon complètement indépendante, hors de tout cadre. J’ai fait le film avec 20 000 Euros.
Qu’est-ce qui a présidé à l’envie de faire des films ? La découverte d’un cinéaste ? Une rencontre ?
Non. Je savais que je voulais faire ça depuis le début. Ce n’est pas un métier, c’est un rêve.
Mais d’où vient le fait de faire du cinéma, c’est-à-dire que le cinéma pouvait être la meilleure forme d’expression ?
Vous savez, quand j’étais très jeune, je pensais que je serai acteur. Je participais à des ateliers de théâtre. Mais j’ai pris conscience très rapidement que je voulais créer et raconter mes propres histoires. Pour moi, c’était très évident. Le fait de parvenir à faire des films était bien entendu la partie la plus compliquée. Le succès en festivals et en salles de mon premier long-métrage fut extraordinaire.
Quels sont les cinéastes qui stimulent votre imaginaire ?
Il y en a plusieurs : Michael Haneke, Ulrich Seidl, les frères Dardenne et Cristian Mungiu. D’un autre côté, j’adore Sofia Coppola, qui fait un cinéma très différent des autres. J’aime aussi beaucoup Darren Aronofsky.
Y’a-t-il des réalisateurs polonais que vous appréciez ?
Lorsque j’étais adolescent, mon idole était Agnieszka Holland. J’ai grandi en regardant ses films.
Un film en particulier ?
Le premier film qui m’a vraiment frappé était Olivier, olivier, qu’elle a réalisé en 1992. Je peux dire que c’est le premier film de ma vie.
Un film produit d’ailleurs par une productrice française, Marie-Laure Reyre… Passons maintenant à votre film Les gratte-ciels flottants, qui raconte une histoire d’amour tragique entre deux jeunes hommes dans la Pologne contemporaine. Vous m’aviez dit un jour avoir eu l’idée de ce film il y a très longtemps, mais qu’il n’était devenu faisable qu’après le succès de Dans la chambre à coucher. Le film se termine assez mal, puisque cet amour est littéralement ravalé par les interdits sociaux et moraux. Un mot sur l’homosexualité masculine en Pologne : pourquoi la norme semble-t-elle indestructible ? Est-il possible de faire un film en Pologne qui montrerait l’homosexualité d’une façon positive ?
Je pense que cela est parfaitement faisable, oui. Je l’ai souvent dit : mes personnages, dans les histoires que je dépeins, sont dévastés à la fin. Ils sont cassés. C’est la raison qui explique la fin de ce film. L’environnement politique et social n’a jamais été l’enjeu pour écrire la fin d’un récit. En tant que scénariste et réalisateur, je n’ai pas vu s’accomplir cette émotion. Il ne s’agit pas de dire si c’est possible ou non. Ceci dit, je crois qu’il est tout à fait envisageable de faire un film positif sur cette question en Pologne. Mais je ne voulais tout simplement pas le faire. En outre, il est vrai que j’ai pensé faire ce film il y a longtemps; mais il avait une forme différente. Au début, je pensais raconter l’histoire d’un amour entre deux femmes. Mais j’ai senti que l’homosexualité masculine posait un problème encore plus grand en termes d’expérience quotidienne. Il s’agit d’un enjeu social : il est plus facile, par exemple, d’accepter de voir deux filles se tenir par la main que de voir deux hommes faire le même geste. Mais peut-être que ce n’est pas plus facile, et que cela dépend de là où on se trouve.
Venons-en à United States of Love, qui sort sur les écran français le 4 avril prochain. Vous établissez dans ce film une image crue de la réalité sociale et sentimentale, qui semble se rapprocher de l’univers dépeint par Ulrich Seidl. Je n’étais donc pas surpris d’entendre son nom parmi les cinéastes auxquels vous vous référez. Comment avez-vous construit l’atmosphère du film ? Pourquoi avoir choisi le chef opérateur Oleg Mutu, qui avait travaillé avec Cristian Mungiu sur le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, 2007) ?
Le travail d’Oleg Mutu m’a toujours impressionné, surtout à partir du film de Cristi Puiu La Mort de Dante Lazarescu (Moartea domnului Lăzărescu) en 2005. Il a le don de savoir comment, en utilisant sa caméra, il peut s’infiltrer dans l’esprit d’un personnage. Il sait faire instantanément le portrait des émotions. J’ai pensé qu’il serait le directeur de la photographie le plus approprié. Ce qui me paraissait important dans ce film n’était pas de faire une œuvre sur le communisme en Pologne. Je voulais ressentir le communisme comme s’il était sous la peau des personnages. Je voulais avoir la sensation du communisme. Oleg Mutu est né en 1972 en Moldavie; il se souvient du communisme en Roumanie. On pouvait parler ensemble des émotions qui provenaient de cette époque. D’un point de vue narratif, le film aurait plus se passer aujourd’hui, mais pas du point de vue émotionnel. Les choix accomplis par les femmes dont je parle auraient bien différents.
« Pourtant, c’est une période capitale; tout d’un coup, nous étions libres, mais nous ne savions pas quoi faire avec. Le communisme était le seul point de repère. »
Vous êtes-vous plongé dans cette période à travers les livres d’histoire ? Il semblerait que la période de transition, en particulier le début de cette époque, soit relativement peu investie. Cette période semble hors du temps, une sorte de trou béant dans l’histoire, n’est-ce pas ?
Oui, c’est vrai. Il n’y a pas de films qui traitent de cette période en particulier. Le film montre ma façon de voir la Pologne de 1990. La pire chose aurait été de reprendre les pensées de quelqu’un d’autre. J’ai situé le film dans la ville où je suis né, Toruń. Les gens que je dépeins sont ceux qui m’ont entouré lorsque j’étais enfant. Mais, bien sûr, il s’agit de ma vision de ces gens. Je voulais raconter cette histoire, parce qu’elle est comme une brèche. Pourtant, c’est une période capitale; tout d’un coup, nous étions libres, mais nous ne savions pas quoi faire avec. Le communisme était le seul point de repère. Imaginez un animal qui a vécu toute sa vie dans une cage, et maintenant que la cage est ouverte l’animal ne sort pas. Pourquoi ? Parce que la cage est sa maison.
Même si le sens de cette histoire est bien plus large et intéressant, n’est-il pas caricaturale de penser le communisme uniquement en terme de « cage » ? N’est-il pas trop simpliste de dire qu’il n’y avait pas de libertés sous le communisme ?
Sous le communisme, il n’y avait pas de libertés. Le régime contrôlait tout.
Vous voulez parler plus particulièrement des années 1980…
Oui. Il n’y avait plus rien dans les magasins. Il n’y avait pas la possibilités de sortir. En 1990, il a fallu apprendre comment utiliser cette liberté.
Tout le film prend comme toile de fond un immeuble (un « blok »). Cela me rappelle la série du Décalogue, réalisée par Krzysztof Kieślowski en 1988. Il part d’un immeuble et raconte les trajectoires de plusieurs personnages qui habitent à cet endroit. Le Décalogue était-il une référence pour vous ?
J’ai vu le Décalogue après avoir monté le film. Je connais le travail de Kieślowski, évidemment. Mais lorsque j’écrivais le scénario, je n’avais pas cette série en tête. Chaque spectateur peut projeter des références sur le film. Peut-être qu’on parle du Décalogue parce que la série parle de la même période. Par ailleurs, mes centres d’intérêt sont proches des siens. Je suis flatté d’être comparé à lui.
Vous choisissez de traiter uniquement de personnages féminins. Pourquoi un tel choix ? Était-ce une façon de montrer que l’existence vécue par les femmes était si différente de celle vécue par les hommes ?
La réalité de cette période, surtout en ce qui concerne les petites villes, faisait que les familles étaient divisées. Une grande partie des pères partaient à l’étranger, aux États-Unis par exemple, pour travailler. Ça a été la réalité de ma famille. Mon père est parti à New York pendant trois ou quatre ans. Lorsque vous partiez, vous ne pouviez pas revenir. C’était de l’émigration illégale. Il nous envoyait des vidéos pour nous montrer sa vie. J’ai repris ce souvenir pour en faire une séquence du film. La vidéo qu’on voit est authentique, elle nous avait été envoyée par mon père.
Les personnages masculins présents dans le film, au-delà de ceux qui sont absents, apparaissent comme totalement impuissants.
Pendant cette partie de mon enfance, je n’étais entouré que de femmes. Je voulais me concentrer sur la perspective féminine, sur leurs sentiments, sur leurs combats.
L’impression rendue par le film est qu’il y a une frontière entre la réalité féminine, et une réalité que nous ne faisons qu’apercevoir, la réalité masculine. Voyez-vous les choses à partir de cette frontière ?
La réalité de cette période était très différente de celle que nous vivons aujourd’hui. La société était plus divisée. Même s’ils pouvaient apparaître comme plus proches, à cause du communisme, la ligne qui séparait les hommes des femmes était criante. D’ailleurs, lorsqu’on regarde les figures féminines dépeintes à cette époque, elles étaient principalement vues soit comme des prostituées, soit comme des mères.
Sauf dans le Décalogue de Kieślowski !
Oui. Vous savez, les rôles sociaux étaient très strictes. Mon père allait travailler, ma mère devait prendre soin des enfants. C’était des rôles très simples. La séparation entre eux était visible. Lorsque je me suis souvenu des femmes qui m’entouraient, j’ai tenté de comprendre quels étaient leurs désirs. Comment elles pouvaient se battre pour leur propre bonheur.
Avez-vous écrit le film seul, ou bien avez-vous fait appel à des collaborateurs ?
J’ai écrit le scénario seul.
Pensez-vous que United States of Love soit un film politique ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas sûr être capable de faire un bon film politique. Un film politique est une œuvre dans laquelle le dilemme principal est un enjeu politique, lié aux discours. Dans mes films, il s’agit seulement des êtres humains, même s’il peut y avoir une dimension politique parfois.
Le film rend compte du renforcement de l’Église catholique au moment de la transition. Pourquoi avoir mis l’accent sur l’omniprésence de l’Église ? Les modèles catholiques encadraient l’intimité ?
Pour le régime communiste, l’Église a toujours été le plus gros problème. Elle avait le soutien du pape polonais. Le combat des gens était soutenu par l’Église. Au-delà du syndicat Solidarność, les églises étaient des lieux de solidarité. Pour une majeure partie de la société polonaise, l’Eglise avait une grande importance. Ma famille était dans ce cas-là. J’ai grandi dans une église, et j’ai été éduqué dans la religion catholique, dans cet environnement traditionnel. Les barrières entre les hommes et les femmes que nous évoquions est à mettre sur le compte de l’influence de l’Eglise. Cette influence, qui existe toujours, a formé la société et les relations.
Le film est déjà sorti en Pologne. Quelle a été la réaction des spectateurs ?
Les réactions ont été très positives. Certaines personnes ont mis en avant le fait que nous avions raconté l’histoire vraie des femmes à ce moment-là. Une histoire qui n’avait jamais été montrée, des voix qui n’avaient jamais été entendues auparavant.
Avez-vous d’autres projets de films ? Voudriez-vous tourner un film à l’étranger, si oui dans quel pays ?
Le film que je suis en train d’écrire décrit la vie d’une femme d’une soixantaine d’années. Et, si l’occasion se présente, j’adorerais travailler en France, en Angleterre, ou ailleurs.
