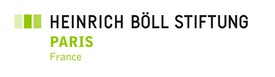En Ukraine, comme dans tous les pays de l’espace dit postsoviétique, une immense partie des transports en commun est assurée par des minibus privés, connus sous le nom de marchroutkas. Malgré la volonté grandissante des pouvoirs publics de vouloir réguler un système à l’origine informel, ces petits autocars continuent de battre le pavé. Reportage.
Article publié en coopération avec la Heinrich-Böll-Stiftung Paris, France.
Texte de Thomas Laffitte, photos d’Ales Piletski (Kiev, correspondance) – Vendredi soir, le minibus est, comme bien souvent, plein à craquer. Les passagers n’ayant pas de siège tentent péniblement de garder l’équilibre tout en ne décrochant pas le nez de leur téléphone, malgré la conduite très nerveuse.
À l’arrêt suivant, un jeune homme parvient à s’infiltrer par la porte arrière. Lui non plus ne lève pas les yeux de son téléphone et, une fois entré et la porte fermée, il tend machinalement la main vers sa voisine de devant pour lui donner un billet de banque. A moitié endormie, elle ne regarde même pas le billet et se contente de le faire passer à son tour. Le billet va ainsi de mains en mains, jusqu’à atterrir dans les mains du chauffeur. Quelques instants plus tard, une pièce de deux hryvnias, qui a fait le même chemin en sens inverse, revient dans la main du jeune homme, qui voyage désormais en règle.
Ce petit manège n’a rien d’inhabituel dans les marchroutkas de Kiev, où la plupart des voyageurs s’acquittent des huit hryvnias requises – soit environ 25 centimes d’euros. Ces petits bus peuvent embarquer une vingtaine de personnes en place assise, mais bien souvent, une cinquantaine de voyageurs s’entassent dans ces petits bus jaunes qui sillonnent les rues de la capitale à vive allure.


Des taxis collectifs face à la faillite des transports publics
De Minsk à Bichkek en passant par Kiev, les marchroutkas ont essaimé dans tout l’espace postsoviétique dès le début des années 1990, ainsi que dans quelques ex-démocraties populaires, comme la Bulgarie ou la Roumanie – un pays où l’on ne dit d’ailleurs pas marchroutka mais maxi taxi.
En effet, ces bus, dont la taille peut varier du simple petit van au petit bus que l’on trouve à Kiev, sont nés à l’origine comme des « taxis collectifs ». L’instabilité politique de la transition avait provoqué au début des années 1990 l’effondrement des transports publics, que les municipalités n’étaient plus en mesure de financer – quand ce n’était pas des problèmes de coupure de courant ou de manque de carburant. Sentant qu’il y avait là un véritable besoin, l’initiative est d’abord venue de personnes possédant une voiture, ce qui était loin d’être commun en Ukraine, l’un des pays où le taux de motorisation était le plus faible.


À ces taxis improvisés se sont vite ajoutées d’autres initiatives pour mettre en service des minibus. « Il s’agissait généralement de bus ou de vans appartenant à des entreprises qui n’avaient rien à voir avec le transport. Elles possédaient des minibus pour aller chercher leurs employés », explique Andrey Vozyanov, anthropologue auteur d’une thèse étudiant le phénomène des marchroutkas. Ces entrepreneurs ont mis en service des minibus qui ramassaient ça et là les habitants cherchant à se déplacer, sans qu’il y ait d’arrêts ou de ligne de bus véritablement définis : les marchroutkas se rendaient là où il y avait un besoin et, à la manière d’un taxi, pouvaient s’arrêter pour laisser monter un passant qui ferait signe en bordure de route.
« Pendant longtemps, les marchroutkas opéraient dans une zone grise à peine régulée, d’où les réseaux mafieux ou criminels n’étaient jamais loin. Finalement, ce système informel s’est banalisé au point de devenir la norme »
Andrey Vozyanov
À mesure que les autorités publiques ont peu à peu recouvré leurs moyens, elles ont cherché autant qu’elles le pouvaient à réguler cette initiative privée et informelle. « Pendant longtemps, les marchroutkas opéraient dans une zone grise à peine régulée, d’où les réseaux mafieux ou criminels n’étaient jamais loin. Finalement, ce système informel s’est banalisé au point de devenir la norme », analyse le chercheur. Au fil des années, le réseau des marchroutkas s’est structuré autour de lignes et d’arrêts de bus fixes.


Un pan de la culture locale
Trente ans plus tard, les marchroutkas font toujours partie du quotidien. Chacun y va de sa petite anecdote – des grand-mères qui tirent les cheveux jugés trop longs des jeunes filles en Galicie, à cette habitude bien ancrée de faire passer la monnaie jusqu’au conducteur sans se servir au passage.
« C’est vrai qu’il y a cette vision très répandue de la marchroutka comme un espace de solidarité et de confiance. Mais ça n’est pas vrai partout. Dans l’est de l’Ukraine, les gens ont moins cette vision-là. Il ne faudrait pas non plus trop romantiser la chose… », décrypte Andrey Vozyanov. Le chercheur met surtout l’accent sur la figure très masculine du conducteur : « comme on ne sait pas si on entre dans un espace privé ou public, le voyageur peut avoir l’impression d’entrer sur le territoire, voire dans l’intimité du conducteur qui, très souvent, décore lui-même le minibus ! »
C’est bien le cas de Yaroslav. Bientôt la quarantaine, conducteur de marchroutkas depuis douze ans, ce féru de pêche a pris le temps de décorer son lieu de travail. « Le bus ne m’appartient pas, mais c’est à moi de l’entretenir, donc au passage, j’en profite pour le décorer », sourit-il. Avec un salaire qui avoisine les 1000 dollars, il dit être content de faire ce travail, malgré les horaires contraignants : trois jours par semaine, il est sur la route de 4 heures du matin jusqu’à onze heures du soir. Il avoue aussi conduire de temps en temps des taxis, en complément, bien qu’il y regrette la froideur et le manque de respect des voyageurs. « Je préfère conduire les marchroutkas, les voyageurs y sont plus polis et respectueux », raconte-t-il.


Nikolai, 40 ans, conducteur de marchroutka depuis 20 ans, n’est pas du même avis. « Les gens essayent de frauder et font tout pour essayer de ne pas payer. En Europe, c’est différent, les gens respectent les règles. » Malgré tout, il est content de faire ce travail, et a même été promu il y a deux ans pour superviser la gestion des minibus. « Cela fait vingt ans que je conduis des marchroutkas, donc c’est peu dire que j’aime mon travail ! », s’exclame-t-il.
Si en Roumanie ou en Moldavie, les chauffeurs de marchroutkas sont parfois perçus comme des personnages malpolis et à la langue bien pendue, en Ukraine, ils sont très vite associés à l’écoute de rouski chansons, ce genre musical qui vient directement du monde criminel et carcéral russe. La mairie de Rivne, dans le nord-ouest de l’Ukraine, a même décidé d’en finir avec ces musiques jugées antipatriotiques, et a officiellement interdit l’écoute de chansons russes dans les transports en commun.


L’abandon des transports publics
En trois décennies, les marchroutkas ont littéralement envahi les rues des villes ukrainiennes et d’ailleurs. Pourtant, les transports en commun soviétiques n’étaient pas mauvais. « Dans les années 1990, ou même parfois aujourd’hui, il n’est pas rare que des maires soient liés au business des marchroutkas. Un grand nombre de municipalités ont donc purement et simplement démantelé les réseaux de transports en commun préexistant, comme les tramways, afin de favoriser l’expansion des marchroutkas », décrypte M. Vozyanov. La capitale Kiev a été particulièrement touchée par ce phénomène. Même si de nombreuses lignes de tramways ou de trolleybus subsistent, de nombreuses lignes ont disparu au tournant des années 2000.
Malheureusement, l’hégémonie des marchroutkas signifie rarement un service de qualité. Ces petits bus étant des entreprises, elles ont besoin de générer du profit, d’où leur appétence pour les routes surchargées et les heures de pointe : une marchroutkas bondée est une affaire rondement menée. Une dépendance trop forte au marchroutkas se traduit donc très vite par une saturation des transports en commun.
Le début de la fin ?
Aujourd’hui, il semble néanmoins que le vent tourne pour ces taxis collectifs. Dans toute la région, on assiste à des reflux, pour des raisons souvent différentes. Au Tadjikistan, le régime autoritaire a mis au pas ces entreprises privées qui échappaient au contrôle de l’État ; à Minsk, les marchroutkas n’ont jamais réussi à prendre le dessus face aux transports publics, et périclitent depuis plusieurs années ; en Roumanie, les maxi-taxis sont vus comme un archaïsme indigne d’un pays moderne et européen.
L’Ukraine n’échappe pas à la règle. A la suite de la révolution de Maïdan en 2014, les villes ukrainiennes ont eu accès à davantage de fonds européens, et ont intensifié leurs jumelages avec leurs consœurs européennes, leur permettant ainsi de se procurer plus facilement du matériel de seconde main pour leur propre réseau urbain. Au point que, dans une métropole comme Marioupol, dans le sud-est du pays, le nombre de marchroutkas a drastiquement chuté. En plus de nouveaux trolleybus, la ville accueille maintenant de nouveaux tramways qui circulaient auparavant… dans les rues de Prague.


D’autres métropoles ukrainiennes, comme Dnipro, sont concernées par ce retour progressif des transports publics, le plus souvent accueilli favorablement par les habitants, qui y voient un signe « d’européanisation » de leur ville. « Cela s’accompagne aussi d’un changement des mentalités : dans les années 1990, prendre un trolleybus était vu comme un ‘truc de grand-mère’, tandis qu’aujourd’hui, les grands bus plus traditionnels sont vus comme un signe de modernité, ce qui encourage d’autant plus les mairies à s’en procurer » explique le chercheur.
A Kiev, cette tendance est moins évidente. Pour Yaroslav, le choix des pouvoirs publics est clair : « Mon bus appartient à la mairie, et comme ils veulent se débarrasser des marchroutkas, c’est à moi d’assumer les coûts de l’entretien. Mais je suis l’exception, à peine 2% des marchroutkas sont publiques, tout le reste relève du privé », explique-t-il. Pour Andrey Vozyanov, il est certain que les marchroutkas n’ont pas dit leur dernier mot : « c’est ce qu’on appelle une technologie fluide : les marchroutkas ont toujours su remarquablement s’adapter, quel que soit l’époque ». Peu de chance donc, que ces petits bus vrombissants disparaissent si tôt des pavés kiévois.