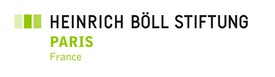Après le siège de la ville, des témoins nous racontent, dans cinq entretiens, leur fuite de Marioupol, l’évacuation ou la déportation forcée en Russie, la filtration avec ses interrogatoires violents et, finalement, le refuge trouvé en territoire libre.
Deuxième partie : La fuite
Kristina & Iryna : « Mon mari est sorti pour voir la voiture. Ça peut sembler ridicule, mais elle était notre chance de survie. Heureusement, elle n’avait pas été touchée. »
Kristina Manko, manucure dans la jeune trentaine, nous a reçus dans l’appartement pragois où elle a trouvé refuge avec son fils Timour et sa belle-mère Iryna.
« Le soir du 15 mars, nous avons vu des voitures passer près de chez nous, des colonnes de voitures. Nous les avons arrêtées pour demander ce qu’il se passe. Les gens se rassemblaient dans le centre et parlaient d’un corridor vert d’évacuation. Nous avons réussi à trouver un signal téléphonique, même s’il fallait pratiquement grimper à un arbre, et mon père, qui est militaire et se trouvait en territoire libre, a pu nous confirmer qu’un corridor était organisé. »
« Nous avons couru à la maison pour rassembler quelques affaires, et notre groupe de dix personnes s’est préparé. Nous étions paniqués mais nous voulions de toute façon partir. Malheureusement, nous avons dû laisser les parents de mon amie qui habitaient avec nous. La mère marchait à peine et nous craignions qu’elle soit incapable de courir à travers champs dans le cas où l’on doive finir à pied. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, donc ils ont décidé de rester, elle et son mari. Nous leur avons laissé nos réserves de nourriture. »
« En partant ce jour-là, nous nous sommes retrouvés dans des embouteillages incroyables. Le couvre-feu approchait et nous ne pouvions attendre. Cela tirait encore autour de nous et tout était miné. On ne pouvait pas voir le chemin avec la tombée de la nuit, surtout qu’il était interdit d’allumer les phares. On pouvait quand même voir que la ville était détruite, c’était comme si elle n’existait plus. Nous avons décidé de rebrousser chemin et de rentrer chez nous pour retenter notre chance le lendemain à l’aube. »

« Quand nous nous sommes couchés, un véritable ‘spectacle’ a commencé, je ne sais pas combien d’avions, mais j’avais l’impression qu’il y en avait une cinquantaine. C’était un vrombissement insupportable, et ils ne lâchaient pas juste une bombe, mais trois, boom, boom, boom, et toi tu es couchée et tu comptes, et tu as l’impression que tu es morte. La maison s’est comme soulevée, les vitres éclataient, les enfants pleuraient. Mon mari est sorti pour voir la voiture. Ça peut sembler ridicule, mais elle était notre chance de survie. Heureusement, elle n’avait pas été touchée. »
« Quand nous avons réussi à quitter la ville, nous avons vu le ciel bleu, nous étions choqués, parce que nous n’avions vu que de la fumée pendant des semaines. »
Kristina Manko.
« Évidemment, plus personne n’a dormi jusqu’à l’aube, personne n’a pris le petit déjeuner, et nous sommes tout simplement montés dans la voiture et partis. Un voisin nous a proposé de le suivre, puis d’autres voitures se sont ajoutées à nous. Tu ne fais que rouler, tu vois autour de toi les voitures détruites, explosées, brûlées, les tanks, les mines. Mais ça ne te touche pas, tu ne fais que rouler, le plus important est de partir. »
« Cette ville n’existe plus. Quand j’ai quitté la ville au volant de ma voiture, je me suis dit que je ne me retournerai pas. Mais j’ai jeté un coup d’œil dans mon rétroviseur et tout ce que j’ai vu, c’est de la fumée. Voilà, que de la fumée. »
« Quand nous avons réussi à quitter la ville, nous avons vu le ciel bleu, nous étions choqués, parce que nous n’avions vu que de la fumée pendant des semaines. Depuis tout ça, nous avons appris à nous réjouir du soleil qui brille et de la pluie qui tombe. De la chaleur, de l’eau, et simplement du silence. Les premiers jours après notre fuite, nous profitions tout simplement du silence. Tu sors le soir et tu entends le silence. Et personne ne va se mettre à tirer. »
Kristina, son fils Timour et sa belle-mère Iryna ont pu rejoindre Zaporijjia et puis ont trouvé refuge à Prague.

Maria Vdovitchenko : « Papa a commencé à perdre la vue, alors qu’il était au volant. Il fallait aller vite, toute la colonne filait, chaque conducteur comprenait qu’une erreur suffirait à faire exploser la voiture. Maman a commencé à tenir le volant et à guider la voiture. »
Maria Vdovitchenko, 17 ans, devait finir le lycée en juin, mais la guerre l’a forcée à l’exil dans l’UE avec ses parents et son petit frère. Elle nous parle au téléphone.
« Un jour, nous avons entendu dire des voisins que des gens tentaient de fuir en voiture et à pied vers Melekine [sud-ouest de Marioupol, sur la rive], que ça ne tirait plus là-bas. Nous avons décidé que c’était le moment de partir. Soit nous restions dans cette cave et nous mourions de faim où on nous tuait, soit nous trouvions un moyen de nous arracher à cet enfer. Surtout que les occupants commençaient déjà à faire le tour des caves. »
« Nous avions une vieille Jigouli et heureusement elle a démarré. Sur les routes, c’était le chaos, tout le monde voulait partir, se sauver. Les gens partaient à pied, avec des enfants. Et il y avait d’énormes embouteillages. Nous sommes arrivés à un barrage et nous avons vu qu’il était tenu par des séparatistes de la DNR [République populaire de Donetsk autoproclamée – NDLR.], que c’était un territoire occupé, mais nous ne pouvions plus faire demi-tour. Ils nous ont contrôlés et ils nous ont envoyés dans une direction sous la menace de leurs armes. »
Récits de l’enfer de Marioupol : « Les gens buvaient l’eau des radiateurs »
« Nous sommes arrivés à Novaïa Yalta et nous nous sommes cachés dans un ancien pensionnat désaffecté sur le bord de la mer. Il y faisait très froid, il n’y avait pas de chauffage ni d’électricité, mais il y avait un puits avec de l’eau. Nous n’avions pas de nourriture et avec l’argent qu’il nous restait, nous ne pouvions quasiment rien acheter. Il n’y avait que deux magasins ouverts avec des produits importés de Russie et les prix étaient très élevés. Nous n’avons pu qu’acheter deux pains. »
« Nous avons attendu dans ce village parce qu’ils ne laissaient personne partir. Les nouvelles autorités d’occupation menaient une purge. Ils cherchaient les ‘fascistes’, les nationalistes, ils fouillaient les maisons à la recherche de symboles nationaux, cherchaient ceux qui parlaient ukrainien. Ils pouvaient arrêter quiconque dans la rue pour les contrôler. Nous avions peur et nous essayions de ne parler à personne, nous restions dans ce pensionnat. Seul mon père sortait. »
« Après vingt jours là-bas, nous avons appris que nous pouvions partir après avoir passé la ‘filtration’. Qu’il fallait avoir ce papier pour pouvoir nous déplacer. Nous sommes partis vers le camp de filtration et il y avait une énorme file de voitures. Nous avons passé deux jours et deux nuits en file. Il était interdit de sortir de la voiture, des soldats armés nous en empêchaient. »
« Papa essayait de marcher, mais il titubait, tombait presque. Il a fini par atteindre la voiture et on est partis sans attendre, même s’il n’allait pas bien. »
Maria Vdovitchenko.
« Notre tour est venu tard en soirée, ils ont laissé ma petite sœur et ma mère malade dans la voiture. Ils ont mené mon père et moi vers une sorte de cabine à deux cents mètres de là. Nous avons attendu une demi-heure dans le froid. J’ai entendu les gardes discuter. L’un a demandé à l’autre : « Qu’est-ce que tu as fait de celui qui n’a pas passé ? – Je l’ai fusillé, ça en fait environ dix, je ne les compte plus », a répondu l’autre. Un homme est sorti de la cabine, il tremblait et il était blanc comme un drap. Il a dit que sa femme n’avait pas passé la filtration et qu’il ne savait pas quoi faire. »
« Ils ont fait entrer mon père et moi dans la cabine, lui dans une pièce et moi dans l’autre. Ils ont pris nos empreintes digitales, nos papiers, nos téléphones. On nous avait dit qu’ils allaient les contrôler, donc nous avions tout effacé. Moi j’avais ajouté quelques photos, quelques contacts, mais mes parents n’avaient rien remis. J’étais dans une pièce avec cinq soldats armés. L’un d’entre eux a dit : « Elle est trop jeune », un autre a dit « Elle ne me plaît pas, il y en aura encore d’autres ». J’ai compris ce qu’ils cherchaient et j’ai eu terriblement peur. Ils m’ont rendu mes affaires et puis ils m’ont poussé dehors. Un soldat m’a raccompagné à la voiture, mais il trouvait que j’allais trop lentement, il m’a poussé jusqu’à ce que je tombe, et il a rigolé. Puis, j’ai couru jusqu’à la voiture. »
« Nous avons attendu papa pendant quarante minutes, puis nous avons vu qu’ils le poussaient dehors. Papa essayait de marcher, mais il titubait, tombait presque. Il a fini par atteindre la voiture et on est partis sans attendre, même s’il n’allait pas bien. Le chemin était terrible, il y avait des voitures calcinées, des blindés, des corps. Les restes humains étaient particulièrement terrifiants. Nous avons réussi à atteindre Berdnyansk. »
« Là, papa nous a raconté ce qu’il s’était passé. Ils ont commencé à vérifier son téléphone, mais il était vide. Ils ont commencé à l’interroger, à lui poser des questions provocatrices sur l’Ukraine, sur ses opinions, sur ce qu’il avait à cacher. Ils ont commencé à le secouer et puis ils l’ont frappé à la tête. Papa ne se souvient pas du reste, il a perdu conscience, puis il se souvient avoir chancelé vers la voiture. »
« Nous avons attendu l’aube et puis nous sommes partis vers Zaporijjia en compagnie d’autres voitures qui cherchaient aussi à rejoindre le territoire contrôlé par l’Ukraine. Des combats étaient menés dans les villages, nous voyions des bombardements au loin, les maisons détruites, les blindés russes. Sur la route, nous avons été arrêtés à 27 barrages. Et à chaque fois, les hommes étaient déshabillés, ils contrôlaient les tatouages, ils fouillaient les bagages. Les soldats volaient les objets de valeur aux barrages. »
« Quand on s’est rapprochés du front, le chemin est devenu très difficile. Il y avait des mines sur la route qu’il fallait contourner. Il commençait à faire nuit et puis à ce moment-là, papa a commencé à perdre la vue, alors qu’il était au volant. Il fallait aller vite, toute la colonne filait, chaque conducteur comprenait qu’une erreur suffirait à faire exploser la voiture. Maman a commencé à tenir le volant et à guider la voiture. »
« Nous sommes arrivés à un barrage où on voyait flotter le drapeau ukrainien et nous avons fondu en larmes. Ma sœur s’est mise à trembler. Papa a dit que le drapeau pouvait être une mise en scène, que ça pouvait être un piège. Nous avons gardé le silence au début et nous leur avons donné nos papiers. Ils parlaient si bien ukrainien que nous avons compris que ce n’étaient pas des occupants déguisés. Nous avons compris que nous étions enfin arrivés, que nous étions sur notre terre. Même l’air était différent et je n’oublierai jamais ce ciel, pur, sans fumée ni explosions. »
« À Zaporijjia, ils nous ont accueillis au centre de réfugiés, puis ils nous ont envoyés à Dnipro pour examiner papa, qui perdait la vue de jour en jour. Là-bas, ils lui ont diagnostiqué une cécité à cause d’une atrophie des nerfs optiques causée par une contusion. Le coup porté avait été si fort qu’il avait endommagé les nerfs optiques. Pour notre famille, c’est une tragédie. Papa nous a sauvées, il nous a tirées de là, et maintenant nous devons le sauver. »
Maria et sa famille ont depuis trouvé refuge dans un pays de l’Union européenne, où ils tentent de faire soigner leur père.
Roman Agachkov : « Je suis terriblement heureux d’avoir quitté ce pays d’orques. C’est de la folie là-bas, il y a leur croix gammée, leur Z, partout dans les villes. Ils roulent en voiture avec leur Z et vous savez ce qu’il est écrit sur leur voiture ? « Pour la paix ». C’est surréaliste. »
Roman Agachkov, employé au port de Marioupol, a dû fuir avec sa femme et sa fille de quelques mois en passant par la Russie. Il nous parle au téléphone depuis Narva, en Estonie, quelques heures après avoir franchi la frontière.
« Mon frère n’habitait pas loin, là où ça ne tirait déjà plus, et un ami à lui est venu nous dire que mon frère viendrait nous chercher pour nous mettre à l’abri. Il n’y avait qu’un kilomètre et nous avons dû passer un barrage tenu par les Russes. Ils nous ont contrôlés et, je ne vais pas vous mentir, ils ne nous ont rien fait. Nous nous sommes installés chez mon frère, où il a un puits et un poêle. »
« Pendant que nous étions là, nous avons vu que ça n’arrêtait pas : les avions volaient, larguaient leurs bombes, tiraient, les lance-roquettes tiraient, les mortiers ; je ne sais pas, je ne suis pas militaire, mais tout venait du côté russe et s’abattait sur la ville. »
« Fin mars, ils ont commencé à distribuer de l’aide humanitaire, puisque les magasins étaient détruits, les gens n’avaient pas d’argent. Quand nous sommes allés en chercher, j’étais totalement choqué par toutes ces maisons détruites, carbonisées. Dans chaque cour, il y avait des tombes, dans chaque cours trois, cinq, dix croix, c’était l’horreur. »
« Pour l’aide humanitaire, il y avait une file énorme, les gens faisaient la queue pendant des jours pour recevoir quelque chose. Heureusement, puisque ma fille est toute jeune, j’ai pu recevoir quelque chose sans attendre. J’ai vu les journalistes russes qui filmaient, genre ils aident les gens après avoir tout bombardé et détruit. »
« Nous étions constamment contrôlés aux barrages, même si parfois avec la petite ils nous laissaient passer. Nous allions dans notre appartement pour tenter de cloisonner les fenêtres brisées et prendre quelques affaires. Après trois semaines comme ça, nous avons compris qu’il fallait partir, mais nous ne voulions pas aller en Russie. Au point de distribution d’aide humanitaire, les Russes nous ont dit qu’ils n’emmenaient les gens qu’en Russie. Ils ne laissaient même plus les gens aller vers l’Ukraine, c’est une déportation de facto. »
« Un policier a hurlé de lui montrer les paumes de nos mains. Vous pouvez imaginer, un mois et demi passé à fendre du bois et à porter des sceaux, j’avais des ampoules et mon index était comme usé, le doigt utilisé pour tirer… ».
Roman Agachkov
« Nous nous sommes enregistrés pour un voyage en autobus, mais le jour du départ, rien ne fonctionnait. Nous avons finalement pu partir deux jours plus tard. Ils nous ont dit que nous irions vers Rostov en passant par Volodarskoho, où nous devrions attendre jusqu’à une semaine pour la ‘filtration’. Nous ne savions pas ce que c’était, mais les gens racontaient entre eux que les Russes allaient vérifier les mains, les bras, les tatouages, les genoux, pour identifier les militaires. »
« C’était un petit autobus bourré de bagages. C’étaient surtout des gens âgés avec des enfants, et les seuls hommes étaient avec leur famille. Nous avions à peine fait trois cents mètres que nous avons été arrêtés à un premier barrage. Ils ont fait descendre tous les hommes, avec leurs affaires. Ils nous ont mis en rang et nous ont emmenés un à un dans une petite pièce, un genre de cabine temporaire le long de la route. Il y avait deux militaires sans insignes, je ne sais pas si c’étaient des Russes ou des séparatistes. Au début, ils ont vérifié les téléphones, ils nous ont demandé où nous allions, avec qui, pourquoi. Ils ne nous ont pas déshabillés, là. »
« À un de ces barrages, j’ai pu voir qu’ils déshabillaient les gens et les arrêtaient vraiment. Je l’ai vu depuis l’autobus. Ils ont arrêté un homme qui aurait proclamé ‘Vive l’Ukraine!’. Je ne sais pas ce qu’ils lui ont fait. Pour eux, juste être pour l’Ukraine, être pour son pays, c’est un motif d’arrestation. »
« J’avais bien effacé mon téléphone auparavant parce que moi j’ai toujours été pro-ukrainien. J’ai vécu toute ma vie en Ukraine, c’est mon pays, je voulais vivre en Europe, que mon pays aille vers l’Europe. Je ne voulais pas de cette DNR, de cette Russie, à quoi elle me servirait ? J’avais effacé toutes les photos, genre avec un drapeau ukrainien pendant une fête. Déjà avant, j’avais dû jeter mon drapeau et tous les symboles ukrainiens de mon appartement, parce que les voisins disaient que les Russes fouillaient les appartements. »
« À Volodarskoho, nous avons dû nous enregistrer. Heureusement, pour les gens avec de jeunes enfants, ils pouvaient nous mettre directement dans un autre bus. Avant de monter, devant la porte, les soldats russes ont fait se déshabiller les hommes. Ils regardaient les tatouages. Moi, je n’en ai pas, je ne suis pas un militaire, juste un civil normal. Puis nous sommes partis. »
« Quand nous sommes arrivés à la frontière russe, le garde-frontière de la DNR, un petit vieux, nous a demandé si nous avions passé la ‘filtration’. Nous avons répondu que non. Il s’est assombri, mais il n’a fait que regarder nos papiers et il nous a laissés passer. Du côté russe, ils nous ont tous faits descendre avec toutes nos affaires. Ils ont fait entrer chaque personne tour à tour dans une pièce, ils ont encore pris les téléphones, il a encore fallu se déshabiller, et ils menaient un interrogatoire : où, avec qui, vous avez été dans l’armée, est-ce que vous avez des connaissances dans l’armée ? Ça a pris trois heures. »
« Quand nous sommes arrivés du côté russe, il y avait des pompiers et des bénévoles, ils nous ont donné à manger. Je suis sorti fumer une cigarette avec des bénévoles, des jeunes. Je leur ai demandé s’ils savaient ce qui se passe en Ukraine et je leur ai raconté : qui bombardait, d’où venaient les tirs, où ça tombait. Ils avaient les yeux ronds, ils n’arrivaient pas à y croire. »
« Puis des policiers sont arrivés et ont encore contrôlé tous les hommes. Encore se déshabiller, vous vous imaginez combien de fois ça faisait ? Un policier a hurlé de lui montrer les paumes de nos mains. Vous pouvez imaginer, un mois et demi passé à fendre du bois et à porter des sceaux, j’avais des ampoules et mon index était comme usé, le doigt utilisé pour tirer… Le policier m’a regardé : « Tu as combattu ? » Je lui réponds que j’ai juste fendu du bois. Il m’a fixé puis il m’a dit, « c’est bon, je te crois ».
« Le frère de ma femme habitait à Rostov depuis déjà avant la guerre dans le Donbass. Il est venu nous chercher et nous a ramené chez lui, où nous avons pu aller sur internet, voir les nouvelles. Nous avons découvert que Kyiv n’avait pas été prise, que notre pays existait encore. Évidemment, je ne voulais pas rester en Russie. Nous avons appris que nous pouvions partir par l’Estonie. Nous avons pris contact avec des activistes russes, qui nous ont acheté un billet pour Saint-Pétersbourg, d’où un gars nous a conduit à la frontière estonienne. Il nous a même donné cinq mille roubles, puisque nous n’avions pas d’argent du tout. J’ai fondu en larmes et lui aussi. Je suis vraiment reconnaissant envers ces activistes. »
« À la frontière, les Russes m’ont dit que je devais maintenant passer la ‘filtration’ et que ma femme et ma fille pouvaient passer. Ma femme a refusé, elle a dit qu’elle attendrait là. Ils ont ramassé plusieurs hommes et ils nous ont fait passer dans une autre pièce. Ils ont tout noté, pris nos empreintes digitales et nous ont pris en photo. Puis ils ont mené un interrogatoire. J’ai inventé que nous allions en Estonie rejoindre des amis de ma femme. Puis ils ont commencé à contrôler mon téléphone et j’ai dû attendre pendant une heure. Tu es assis, tu as peur et tu te dis qu’il faudrait partir au plus vite. Ils nous traitaient comme des criminels. Et puis enfin ils nous ont laissés partir. »
« Je suis terriblement heureux d’avoir quitté ce pays d’orques. C’est de la folie là-bas, il y a leur croix gammée, leur Z, partout dans les villes. Ils roulent en voiture avec leur Z et vous savez ce qu’il est écrit sur leur voiture ? « Pour la paix ». C’est surréaliste. Dans le train, ils étaient comme des zombies, ces Russes. Ils discutaient entre eux et disaient qu’ils allaient bombarder la Finlande et qu’il n’en resterait qu’une île. Ils ont perdu le sens de la réalité. Le douanier m’a même demandé pourquoi je ne voulais pas rester en Russie. Je n’ai même pas répondu. Qu’est-ce que je peux bien leur expliquer ? »
« Vous pouvez écrire mon vrai nom au complet, j’espère que je ne me retrouverai plus jamais en Russie. »
Roman et sa famille ont pu trouver refuge en Finlande.
Lioubov Golovtchenko : « À Saint-Pétersbourg, des activistes nous ont aidées avec leurs familles, à leur risque et péril. Ils ne soutiennent pas Poutine. »
Lioubov Golovtchenko, entraîneuse de sport, travaillait à Kyïv avant la guerre. Atteinte de la Covid-19, elle avait décidé juste avant l’invasion d’aller passer sa quarantaine dans sa ville natale de Marioupol, chez sa jeune fille. Lioubov a depuis trouvé refuge en Estonie, d’où elle nous raconte.
« Le 23 mars, les soldats russes nous ont chassés de la cave sous la menace de leurs armes. Ils nous ont mis dans un autobus et envoyés à Volodarskoho, puis ils nous emmenés vers Taganrog [en Russie]. À la frontière, ils m’ont laissée tranquille comme j’étais à peine consciente, mais ils ont contrôlé ma fille. Ils lui ont pris son téléphone et l’ont interrogée pendant un jour entier quand ils ont appris que son copain était officier dans l’armée ukrainienne. Elle n’a pas voulu me raconter pour ne pas m’inquiéter, mais j’ai compris que c’était terrible, elle est en sortie toute pâle. »
« Du côté russe, ils nous ont mis dans un train gardé par des soldats armés. Nous ne savions même pas où on nous emmenait et les soldats ne nous ont dit qu’au moment du départ que nous allions à Penza [à 1000 kilomètres au nord-est de Marioupol]. Le train a roulé pendant une journée sans arrêt jusqu’à Penza. Ils ne nous ont pas donné de choix, ils ne nous ont rien dit. »
« À Penza, ils nous ont installés dans une base militaire, quelque part dans la forêt. Elle était entourée d’un grand mur avec du fil de fer barbelé, des soldats armés partout, impossible de sortir. Comme j’avais de graves blessures, ils m’ont emmenée à l’hôpital et ils m’ont enlevé un éclat de bombe de la tête. À l’hôpital, les citadins étaient stupéfaits qu’ils nous aient installés dans cette base : ‘C’est là que Poutine a enterré des déchets radioactifs, nous n’allons même pas chercher des baies ou des champignons là-bas, la radiation est trop forte’, qu’ils disaient. »
« J’avais pris nos papiers avec moi donc les soldats n’ont pas pu nous les enlever comme aux autres. Ma fille m’écrivait que tous les réfugiés étaient pris de panique et se sentaient comme pris en otage. Ils obligeaient les gens à demander l’asile en Russie, et même la nationalité russe. Grâce à son copain, elle a pu prendre contact avec des activistes russes de Saint-Pétersbourg, qui nous ont acheté des billets de train et nous ont fourni un document de protection de la Croix-Rouge. Avec ça, ils nous ont laissées partir. »
« À Saint-Pétersbourg, les activistes nous ont hébergées pour une nuit et nous ont mises dans un train pour la frontière estonienne le lendemain. Ces activistes nous ont aidées avec leurs familles, à leur risque et péril. Ils ne soutiennent pas Poutine. »
« Je ne compte pas rentrer à Marioupol tant qu’elle sera sous occupation russe. Je ne veux pas revenir là où les Russes nous ont bombardés, tués. J’ai beaucoup d’amis et je regarde sur les médias sociaux, je vois qu’ils n’ont pas été actifs depuis longtemps. Je ne sais même pas ce qui leur est arrivé, ni où ils sont. »
« En Russie, ils m’ont enlevé un éclat de la tête, mais pas celui qui est dans ma gorge. Ils m’ont dit qu’il faudrait un chirurgien militaire pour ce genre d’opération, qu’eux ne pouvaient pas le faire. Je n’ai pas encore vu de médecin ici. Au début, ça me dérangeait, mais je me suis habituée. »
« Je voulais garder ma fille avec moi ici en Estonie, mais elle est rentrée parce qu’elle a son amoureux, son officier. Elle m’a dit qu’elle était prête à traverser des forêts et des marécages, mais qu’elle le retrouverait. »
Ksenia : « Les gens dormaient par terre dans ce camp, une sorte de gymnase d’école dégageant une puanteur ignoble. »
Ksenia, nom d’emprunt pour une jeune mère, qui préfère taire son vrai nom pour éviter des ennuis à sa famille restée à Marioupol. Elle a pu fuir par la Russie et trouver refuge en Europe, d’où elle nous a parlé.
« Fin mars, nous avons décidé qu’il fallait partir. Nous avons trouvé une voiture toute cabossée mais qui roulait quand même. Ce jour-là, ils ont fermé la route vers Zaporijjia et les soldats russes ont annoncé que Marioupol serait bloquée à partir du lendemain pour y mener une purge. Nous avons rassemblé nos affaires en dix minutes pour quitter la ville avant le couvre-feu. Il y avait de nombreux barrages, où les hommes se faisaient déshabiller, et puis les routes étaient minées. Parfois, nous devions tâter le terrain à pied avant d’avancer en voiture. »
« À un des barrages, j’ai vu par la fenêtre comment ils déshabillaient un homme et vérifiaient ses tatouages. Ils lui ont bandé les yeux et l’ont jeté dans une voiture. Ils ont emmené deux hommes comme ça. Où les ont-ils emmenés ? Qu’ont-ils fait d’eux ? »
« Nous sommes arrivés à Volodarskoho, où il y avait un camp pour ceux qui tentaient de partir. Nous sommes arrivés en soirée et ils nous ont dit que nous devions nous inscrire pour la ‘filtration’. Nous étions inscrits dans le cinquantième autobus et ils n’en faisaient passer que deux ou trois par jour. Les gens dormaient par terre dans ce camp, une sorte de gymnase d’école dégageant une puanteur ignoble. Ils devaient attendre parfois jusqu’à une semaine. »
« Nous avons appris que d’autres autobus viendraient chercher des gens le soir pour les emmener à Rostov [en Russie]. Ils sont arrivés et ont annoncé qu’ils emmenaient les gens sans les faire passer par la ‘filtration’. Évidemment, s’y asseoir sans trop savoir où ils allaient vraiment nous emmener, c’était un énorme risque. Nous avons attendu deux heures que les autobus se remplissent, parce que beaucoup de gens avaient peur de partir dieu sait où, sans passer par la filtration. »
« Ils nous ont emmenés vers Taganrog, à la douane russe. Nous avons attendu longtemps, mais tout était correct, ils n’étaient pas agressifs. Finalement, ils n’ont contrôlé que les hommes, ils ont vérifié leurs téléphones, ils leur ont posé des questions, mais sans provocation, contrairement à d’autres amis à nous qui sont passés par la filtration. »
« Finalement, ils nous ont laissés à Taganrog et non pas à Rostov, mais des proches à nous vivant en Russie sont venus nous chercher. Ceux qui n’avaient personne ont été mis dans un train sans aucune information. Ils les envoyaient un peu partout, sans les informer. Ces gens n’avaient ni argent, ni nourriture, ni logement ; ils les mettaient dans des trains et les envoyaient. Ils nous ont proposé de nous inscrire comme réfugiés pour recevoir de l’aide, mais nous savions qu’ils prendraient nos papiers et qu’ils nous assigneraient à une région sans avoir le droit de la quitter. »
« Nous sommes restés chez nos proches où nous avons pu nous remettre un peu. Puis, nous avons envoyé deux d’entre nous sans bagage ni enfant pour tester le chemin par l’Estonie. Quand ils nous ont confirmé que c’était possible, même sans passeport, nous avons pris le même chemin. »
« Les gens nous ont bien reçus en Estonie, mais je ne veux pas vivre dans un pays voisin de la Russie, j’ai trop peur. Je n’ai pas le courage de revivre tout ça. Pour Marioupol, même si l’Ukraine la reprend, je n’ai nulle part où rentrer. Mon travail, mon entreprise, et mon appartement, évidemment, tout est détruit. En fait, il n’y a plus de ville. »
Ksenia et les siens sont partis vers l’Europe de l’Ouest.
Article publié avec le soutien de Heinrich Böll Stiftung | Bureau Paris – France.